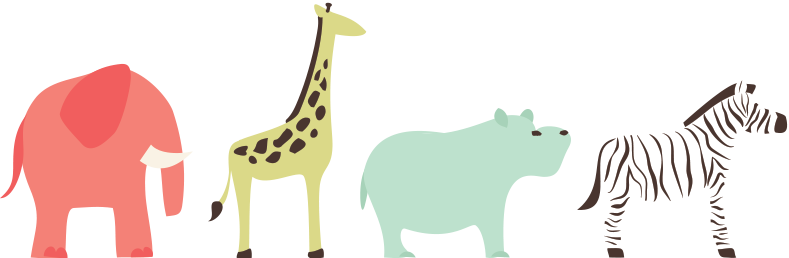VIIIe Traité, Le livre des lumières
Quand je lus mes premiers poèmes,
je sentis que c’était « une bénédiction d’être vivant par un pareille aurore ». Ici, les mots étaient transfigurés,
ils s’envolaient de terre et montaient jusqu’au ciel !
Je pense que mon premier contact avec les rimes
a été d’entendre mon père lire à haute voix les Lais de la Rome antique. Le mouvement métrique était enivrant ; je sens encore les battements de mon petit cœur en l’écoutant !
Mais cette première bouchée ne fit qu’aiguiser mon appétit,
et je me plongeai dans Tennyson, le seul autre poète accessible. Ici se trouvaient vraiment des « royaumes dorés ». Mon plaisir devant la beauté rythmique de Locksley Hall et d’In Memoriam n’était gêné par aucun effort intellectuel, car je ne comprenais presque aucun mot de ce que je lisais.
Les poèmes plus simples, que je pouvais comprendre en partie –La Reine de mai, par exemple, ou Clara Vere de Vere-, m’intéressaient beaucoup moins ; mais je dois avouer que j’avais un faible pour le Seigneur de Burleigh, basé, je pense, sur son intérêt documentaire comme tableau de l’amour et du mariage (sujets qui, déjà, retenaient profondément mon attention).
Pascal Quignard
« La vie et moi, autobiographie inachevée »
Mon père m’enseigna l’alphabet, et il s’apprêtait à me faire distinguer « chat » de « rat », lorsqu’un beau jour, on me découvrit assise dans le salon, en train de lire une pièce intitulée « Fanny Lear », d’Halévy, je crois. Ni moi ni personne dans ma famille ne se rappelait que je fusse passée par les étapes intermédiaires, et de ma progression, je ne me souviens de rien d’autre que du fait que
je parcourais les pages de M. Halévy avec une apparente maîtrise de la signification des mots courts et de la sonorité des mots longs. Quand je pense
au soin avec lequel, par la suite, on a surveillé
mes lectures jusqu’au jour de mon mariage,
il me semble bien étrange que j’aie commencé par l’histoire d’une prostituée !
Dès lors, je fus captivée par les mots ;
peu m’importait de les comprendre ou non :
la sonorité était l’essentiel.
Ils me chantaient aux oreilles comme les oiseaux d’une forêt magique. Et ils avaient un aspect autant qu’une sonorité : chacun avait ses mouvements et sa physionomie. Quel attrait pouvaient bien avoir les poupées pour une enfant qui disposait de jouets aussi merveilleux, qu’en plus elle pouvait, elle le savait, remplacer par d’autres encore plus merveilleux dès qu’elle s’en lassait ?
Edith Wharton
Donner à voir
Les poèmes ont toujours de grandes marges blanches, de grandes marges de silence où la mémoire ardente se consume pour recréer un délire sans passé. La principale qualité est non pas je le répète, d’invoquer mais d’inspirer.
Lire, pour m’endormir ailleurs et revenir le lendemain, si je peux, quand je peux, des mois et des années plus tard si je veux.
Laisser un inconnu me créer des souvenirs, des personnages imaginaires qui sont devenus mes amis, en aventures dont je me sens digne ou capable – au moins le temps d’arriver à la dernière page. Enrager que ce soit fini.
Pleurer toute seule dans mon canapé.
Envier des bonheurs.
Apprendre. Se reconnaître et se sentir moins seule alors. Pour apprécier le mystère de l’auteur. Celui qui réussit à venir à bout de son idée, à tenir tête à ses pannes d’inspiration, à se laisser enchaîner à son histoire, à oser se donner à lire.
Et me dire au fond, que puisqu’il a osé et qu’il n’est pas mort, c’est que l’imagination est une souveraine finalement clémente.
Paul Eluard (1895-1952)
L’enfant que j’ai été, frère de six sœurs, collées à toute heure à cette mère, belle, coquette et séduisante qui s’égarait dans des continents vertigineux du conte et les paradis d’histoires fabuleuses racontées dans un arabe mélangé de berbère et de français…
Des histoires sur l’amour, les trahisons, les belles femmes, les cadis, la pauvreté, la richesse, l’argent, la sagesse, les juifs, les musulmans, les roumis, l’opportunisme, les guerres, la paix, le courage, la fidélité, les enfants, les animaux, les vices…
La voix de notre mère nous « chantait » de belles histoires comme les prières. Elle qui fut durant un demi-siècle, chanteuse dans les mariages, les circoncisions et les fêtes religieuses, nous initiera avec sa voix de miel aux contes fabuleux dont le fil interminable me liera aux personnages qui ne cessent de railler les sociétés oppressantes et de leurs symboles tyranniques.
Des histoires sur l’amour, les trahisons, les belles femmes, les cadis, la pauvreté, la richesse, l’argent, la sagesse, les juifs, les musulmans, les roumis, l’opportunisme, les guerres, la paix, le courage, la fidélité, les enfants, les animaux, les vices…
Ma mère, cette dame, illettrée, a été mon enseignante avant le livre des Mille et une Nuits. Vingt ans après, peut-être un peu plus, ma mère, cette bibliothèque vivante restera, à l’origine des livres que j’ai lus et aimés. Garcià Màrquez, Fuentes, Le Clézio, Mahfouz…
Amin Zaoui
La Dame de l’Ile
Une dame, sur une belle île, demandait où aller se promener. Les vraies cartes affichées, pliées à emporter, les vrais chemins et les vraies routes qui venaient s’accrocher aux frontières de la cour caillouteuse devant la maison avaient pourtant été créés pour ça ! Leur rôle était bien de promener les passants, de passer d’un point de vue à un autre, de fréquenter l’herbe et l’asphalte, de descendre dans les profondeurs des vallons, d’accéder à la fraîcheur du ruisseau, d’affronter le vent sur la falaise. On disait même qu’à un bout
De l’ile, un phare et son escalier offraient une certaine vision de l’ensemble.
Les cartes, les chemins, les routes et les escaliers sont patients. Très, très patients parfois… Ils restent optimistes et exigent qu’on les entretienne pour accueillir les promeneurs éventuels.
Ils sont là pour ça.
Alors ils attendent. Ils espèrent simplement qu’une personne de confiance invitera cette dame, choisira pour elle une première entrée dans l’île. En sécurité.
Alors, les frondaisons des bois, les passages de gibiers,
la croisée de chemins, les points de côté dans la montée
et la solitude sous un ciel si haut ne seront plus inquiétants pour la dame.
Une fois suffit, peut-être deux, et la dame ira son chemin.
Moi souvent, je suis cette personne : je pars avec, je lis avec, j’écris avec, j’accompagne.
On ne peut pas rester toute une vie dans sa cour !
Jeanne VILBERT
Marie-Claire
Maintenant que j’étais servante de ferme, il me fallait tuer les poules et les lapins. Je ne pouvais m’y décider, et la fermière ne comprenait rien à mes répugnances. Elle disait que j’étais comme Eugène qui se sauvait quand on tuait le cochon. Je voulus pourtant essayer de tuer un poulet pour montrer ma bonne volonté. Il se débattait entre mes mains, et bientôt la paille fut toute rouge autour de moi. Quand il ne bougea plus, je le déposai dans la grange en attendant que la vielle Bibiche vînt le plumer ; mais elle se moqua bien de moi, en retrouvant le poulet sur ses pattes au milieu d’un van plein de graine. Il mangeait goulûment, comme s’il eût voulu se guérir au plus vite du mal que je venais de lui faire. La vieille Bibiche le saisit et, quand elle lui eut passé la lame sur le cou, la paille fut beaucoup plus rouge que la première fois.
Pendant l’heure de la sieste, je montais au grenier pour lire un peu. J’ouvrais le livre au hasard ; et, à le relire ainsi, j’y découvrais toujours quelque chose de nouveau. J’aimais ce livre, il était pour moi comme un jeune prisonnier que j’allais visiter en cachette. Je l’imaginais vêtu comme un page et m’attendant assis sur la solive noire. Un soir, je fis avec lui un beau voyage.
Après avoir fermé le livre, je m’accoudai à la lucarne du grenier. Le jour était presque fini, et les sapins paraissaient moins verts. Le soleil s’enfonçait dans des nuages blancs, qui bouffaient et se creusaient comme du duvet. Sans savoir comment cela s’était fait, je me trouvai tout à coup au-dessus du bois avec Télémaque. Il me tenait par la main, et nos têtes touchaient le bleu du ciel. Télémaque ne disait rien ; mais je savais que nous allions dans le soleil. La vieille Bibiche m’appelait d’en bas. Je reconnaissais très bien sa voix, malgré la distance. Elle devait être bien en colère pour crier si fort. Je me souciais peu de ses cris. Je ne voyais que le duvet brillant qui entourait le soleil, et qui commençait à s’ouvrir pour nous laisser passer.
Un choc sur le bras me fit retomber dans le grenier. La vieille Bibiche m’écartait de la lucarne en disant :
– « S’il y a du bon sens à me faire crier comme ça ! Voilà plus de vingt fois que je t’appelle pour manger la soupe ». Peu de temps après, je ne retrouvai plus le livre sur la solive. Mais c’était un ami que je portais dans mon cœur, et j’en gardai longtemps le souvenir.
Marguerite Audour
Des Boutures d’écritures
« Branche qui, coupée à un arbre et, plantée en terre, prend racine ». C’est la définition pour le mot « bouture » d’Emile Littré.
Ce qu’on sépare de la littérature, par imitation, essai, manipulation, reprise, risque ou saut, est vivant. C’est la branche retirée de l’arbre. Et puis il y a la terre : notre expérience du présent, sa complexité, ses opacités. La nécessité d’y prendre mot pour s’y conduire, agir et transmettre. Et puis évidemment racine : parce que ce qui s’essaye là, collectivement, timidement ou dans l’éclat, n’est pas une fin en soi, mais une amorce, à partir de quoi l’autre grandissement se fera, selon l’endroit de la pousse, et dans une temporalité qui lui appartiendra en propre.…
Cet enracinement est vital, parce qu’il est chose collective et chose de risque. Il prend sens parce qu’il devient ainsi pluriel, et partage. On ne démontre rien, on essaye, on offre. Et ce qui s’offre à visage et vie, enfance et rêve, devient langue parce qu’émotion.
Cet enracinement est précieux, parce qu’ici il se donne dans ces « boutures d’écriture » non pas comme aboutissement ou démonstration, mais envie de continuer, multiplier les relais. En donne aussi le mode d’emploi.
François Bon
Le Pavillon des cancéreux
D’ailleurs, quand les hommes lient connaissance, après la question « comment t’appelles-tu? » vient tout de suite : « que fais-tu ? » « combien gagnes-tu ? ». Et si un homme ne réussit pas à gagner de l’argent, ça veut dire que c’est un benêt ou un type qui n’a pas de chance, de toute façon, un minus. […]
De vrais poules, quoi ! Les poules ont beau savoir que chacune d’elles aura le couteau en travers de la gorge, elles n’en continuent pas moins à glousser et à gratouiller pour trouver leur nourriture. Et on peut bien en prendre une pour l’égorger, ça n’empêchera pas les autres de gratouiller.
Ainsi, jour après jour, Poddouïev arpentait le vieux parquet dont les lames ondulaient sous son poids, mais il n’arrivait aucunement à éclaircir la question : comment faut-il donc accueillir la mort ?
Inventer la réponse ? Ça n’était pas possible… La recevoir de quelqu’un ? Personne n’était capable de la donner… Quant aux livres, c’était bien la dernière chose qu’Ephrem aurait pensé à consulter…
Jadis il avait été à l’école primaire, puis à une école du bâtiment, mais il n’avait jamais senti personnellement le besoin de lire : la radio lui remplaçait les journaux; pour ce qui est des livres, ils lui semblaient parfaitement inutiles dans la vie de tous les jours.
Dépenser de l’argent pour des livres ou bien encore, se fatiguer à aller les chercher dans une bibliothèque lui semblait tout bonnement ridicule. Et si, d’aventure, il lui en tombait un sous la main pendant un voyage ou dans une salle d’attente, il en lisait vingt à trente pages, et toujours il finissait par abandonner, n’ayant rien trouvé qui traitât du juste emploi de la vie.
Ici aussi, à l’hôpital, il y en avait sur les tables de nuit et sur le rebord des fenêtres, mais il n’y touchait même pas. Et il n’aurait pas non plus touché à ce petit livre bleu avec des arabesques dorées, si Kostoglotov ne le lui avait pas refilé un certain soir, encore plus vide et plus écœurant que les autres soirs. […]
Ajoutons qu’il n’aurait pas entamé la lecture si ç’avait été un roman. Mais c’était de petits contes de rien du tout où tout était dit en cinq, six pages et quelquefois en une seule. La table des matières fourmillait de titres […] : « Le travail, la mort et la maladie. » « La loi essentielle. » « La source. » « Qui sème le vent récolte la tempête. » « Trois cœurs. » « Marchez dans la lumière tant qu’il y a de la lumière. »
Ephrem en chercha un plus court que les autres. Il le lut. Ca lui donna envie de réfléchir. Il réfléchit. Il eut envie de relire. Il relut. Et à nouveau, il eut envie de réfléchir. Et il réfléchit à nouveau.
La même chose se produisit avec le second récit. […] Dans l’obscurité, il raconta une fois encore à Akhmadjan la vieille fable d’Allah qui avait divisé la vie en plusieurs parts, et comment l’homme avait reçu en partage beaucoup de parts inutiles (d’ailleurs lui-même n’était pas d’accord, aucune part de vie ne lui semblait inutile, à condition qu’on ait la santé). Puis, avant de s’endormir, il réfléchit encore à ce qu’il avait lu. […]
Déjà, hier au soir, Ephrem avait remarqué le titre suivant : « Qu’est-ce qui fait vivre les hommes ? » Ca, c’était un titre bien envoyé, à croire qu’Ephrem lui-même l’avait trouvé. Car tout en arpentant le parquet de l’hôpital, à quoi d’autre pensait-il donc ces dernières semaines, sinon à cette question, encore informulée : « Qu’est-ce qui fait vivre les hommes ? ».
Alexandre Soljénistyne